La vérité et la raison ne sont pas des opinions (2)
Lisez la première partie de cet article
L’école des philosophes mégariques, fondée par Euclide de Mégare au IVe siècle avant J.-C., se concentre d’abord sur la modalité épistémique, s’intéressant en premier lieu à la manière dont la raison humaine appréhende la connaissance. Ses penseurs, en réfléchissant sur la nature des propositions possibles, introduisent l’analyse en syllogisme modal et s’interrogent sur le statut de la croyance par rapport à celui de la connaissance factuelle : il va s’agir de déterminer si la première peut être considérée comme épistémologiquement fondée ou pas, donc traitée ou pas comme une connaissance réelle et viable. Ils contribuent au premier essor formel de la logique déductive et adoptent la modalité propositionnelle, qui se distingue de la logique aristotélicienne sous deux aspects fondamentaux : 1) en ne posant que des références propositionnelles individuelles (des évènement « désessentialisés ») ; et 2) en cherchant avant tout à établir les critères de raisonnement les plus aptes à distinguer le possible de ce qui ne l’est pas.

La grande contribution modale des penseurs mégariques gravite donc principalement autour du statut épistémologique de la possibilité (δυνατόν) et aux strictes conditions de sa négation : seules les choses « certaines » – dont la certitude ontologique implique qu’elles ne peuvent pas ne pas arriver – sont proprement « possibles ». Les Mégariques nieront, par conséquent, la possibilité de ce qui est incertain ; et même de ce qui est inconnu, contraignant la connaissance du possible à la norme de la certitude ontologique première. Ils insisteront sur le fait que seule la certitude peut servir de base adéquate pour la connaissance, rejetant l’idée que quelque chose puisse être probable sans être, en dernier ressort, certain. À l’opposée d’une épistémè constructiviste d’inspiration « woke », les Mégariques considèrent la vérité comme seule condition nécessaire à la connaissance : une croyance ne peut être considérée comme une connaissance que si elle est vraie. Chose remarquable, ces premiers formalistes de la modalité logique ne préjugent pas de la véracité du contenu d’une proposition x (matérielle, philosophique, religieuse). Pas de biais cognitif scientiste ici. Le vrai peut s’imposer à l’encontre de ce que l’on croit déjà savoir. L’approche et les réflexions séminales des Mégariques portant sur la possibilité et sur la nécessité en matière de connaissance ont contribué de manière significative au façonnement ultérieur de la logique et de la métaphysique inséparables de la pensée scientifique occidentale.
Également au IVe siècle avant J.-C., l’école des philosophes stoïciens sera fondée par Zénon de Kition. Le système d’inférence stoïcien est basé sur un ensemble classifié de propositions catégoriques, hypothétiques, disjonctives et conditionnelles composées (de la forme « si… alors… »). Il met en œuvre différents moyens d’analyse formalisée des relations causales et conditionnelles de l’expression logique de la pensée. Son développement par les successeurs de Zénon influencera jusqu’aux questions très ultérieures des anticipations modernes de la logique scolastique. L’éthique et la logique stoïciennes sont étroitement liées, et la notion de καθῆκον (kathékon), de conformité à la nature et à la raison, y occupe une place centrale (les Stoïciens antiques seraient particulièrement horrifiés par nos infractions contemporaines militantes vis-à-vis d’un tel devoir universel de la pensée et de l’agir proprement humains). Dans le stoïcisme (comme dans l’aristotélisme), à l’encontre de notre régressisme antispéciste contemporain, la raison distingue radicalement l’homme des animaux. Atteindre la vertu et de la sagesse passe donc par l’exercice de la logique pratiquée comme disciplinaire de l’âme se conformant à la « raison cosmique ». Le propre de cette harmonisation stoïcienne, en l’homme s’accordant à l’ordre naturel de la nature, se vérifiera donc dans sa formation de jugements corrects et rationnels contre la prolifération irrationnelle des impressions et des croyances contrefactuelles.
De son côté, Socrate mettra l’accent sur la recherche de la connaissance obtenue, non seulement par le biais de l’enquête rationnelle, mais en outre par le questionnement (questionnement de type scientifique fondamental, initié par l’étonnement), s’efforçant de parvenir à la vérité objective par l’effort diligent d’une réflexion axée sur le raisonnement dialectique. Platon, un de ses plus fameux élèves, entrevoit la réalité intelligible et la fonction épistémique de vérités éternelles (d’idées archétypales méta-conjecturelles) ; il a fondé la notion ontique de réalité objective, qui pouvant être découverte par la raison et par l’enquête proprement philosophique (allégorie de la Caverne dans la République). Aristote, élève de Platon, développera une approche analytique de la logique (en sujet/prédicat, ou substantif/adjectif), jetant les bases du raisonnement syllogistique classique et de la classification des connaissances en différentes disciplines.
Au Moyen-Âge, la relation entre la foi et la raison occupe une place épistémologique centrale, que la modernité perdra par illusion scientiste et une méconnaissance profonde des bases de l’authentique science moderne. Saint Augustin, Saint Thomas d’Aquin, Saint Bonaventure et Jean Duns Scot en particulier les réconcilient à travers leurs œuvres sous forme de commentaires et de synthèses respectives. Saint Thomas va notamment souligner l’unité de la raison en ce qu’elle conduit à la fois à la connaissance du monde naturel (des vérités naturelles qu’il recèle) et sous-tend l’adhésion de l’intelligence (dans l’acte théologal de foi) au contenu des vérités surnaturelles. Duns Scot, tout aussi dévoué à la cause de l’unification épistémologique de la foi et de la raison (unification capitale dans le collimateur hérétique du protestantisme et de la modernité), va de son côté poser d’entrée la carence intrinsèque d’une philosophie laissée à ses propres principes et préjugés naturalistes. Il fait remarquer que « les philosophes maintiennent la perfection de la nature et nient la perfection surnaturelle » ; alors que, par contraste, « les théologiens reconnaissent le défaut de la nature et la nécessité de la grâce et de la perfection surnaturelle ». Perfection naturelle et perfection surnaturelle ont une seule et même source exemplaire – dirait Saint Bonaventure de l’essence divine elle-même – et répondent par conséquent, dans leur principe commun, d’une seule et même vérité. Il faudrait le redécouvrir aujourd’hui, pour sortir une fois pour toutes des apories tristement durables tant du scientisme que du fidéisme…….

L’idéal intellectuel scolastique représente une véritable mise en œuvre d’une vision holistique transculturelle du rapport objectif de la raison et du discours à la vérité, selon des critères précisément rationnels. Vision qui ressort tout particulièrement des œuvres majeures des grandes figures susmentionnées. L’exercice proprement scientifique de l’intelligence qu’elle met en avant en visant à la compréhension et à la communication universelle du vrai, repose sur les quatre grandes caractéristiques suivantes – dont les injonctions épistémologiques contemporaines d’obédience « woke » reposent sur un anathème programmatique propre à un regard contre-scientifique, foncièrement conditionné par son adhésion structuraliste à l’illusion cognitive délirante de la plasticité existentialiste : 1) la nécessité du vrai comme objet premier de la science ; 2) la réalité de l’objet de connaissance, premier fondement de la persuasion extra-subjective de l’intellect agent ; 3) l’évidence des prémisses de la pensée ; 4) la rigueur logique.
La Renaissance sera marquée par un regain d’intérêt pour la pensée classique grecque et romaine, lequel favorisera un goût plus éclectique mais moins systématique de la recherche et de la connaissance. Le siècle dit « des Lumières », mouvement intellectuel des XVIIe et XVIIIe siècles, se voudra « défenseur de la raison » (dont Robespierre et consorts iront jusqu’à faire une déesse, également jusqu’à en perdre leurs têtes « lumineuses » démocrates en passant par la case guillotine), de la science et de la méthode empirique comme moyens de rendre compte de la vérité objective vérifiable. Des penseurs comme Francis Bacon, René Descartes, Blaise Pascal, John Locke, Gottfried Leibniz, Nicolas Malebranche, et Emmanuel Kant joueront un rôle indisputable dans l’élaboration des conceptions modernes de rationalité et de vérité. La distinction entre vérité objective et opinion subjective s’accentuera au cours de cette période.
De son côté, David Hume mettra en doute la fiabilité de la perception humaine et du raisonnement inductif, se contraignant à une posture sceptique stérile quant à la possibilité d’une connaissance certaine, qu’il retraduira néanmoins sous la forme absolutiste d’une fausse sagesse épistémique encore très en vogue aujourd’hui, celle du doute absolu, seule prétendue « certitude ». Hume, pour autant, soulèvera (avec Karl Popper) une vraie question de nature épistémologique pérenne quant au problème de l’induction : comment justifier rationnellement les généralisations et les théories scientifiques qui en découlent à partir d’observations limitées ?
Pour y répondre, avec plus ou moins de succès, l’inductivisme suggérera, en appliquant le paradigme progressiste usuel en science moderne, que la connaissance se construit de plus en plus solidement au gré de l’accumulation d’observations. Le falsificationnisme contrera cet optimisme naïf en postulant que les théories scientifiques doivent être soumises à des tests rigoureux pour résister à la réfutation. Le bayésianisme enfin emploiera la théorie des probabilités aux fins d’évaluer la crédibilité des hypothèses scientifiques. Aucune de ces alternatives ne résout complètement la dubitation épistémologique humienne.
Nietzsche critiquera l’idée de vérité en passant par une généalogie de ses formes successives qui, selon lui, la manifeste tour à tour en tant qu’illusion régulatrice apollinienne (cette impulsion fondamentale de sublimation de l’énergie dionysiaque illustrée par la culture grecque), que pragmatisme vital (ou utilité instinctive pour la vie), et qu’objectivation de la volonté de puissance humaine de façonnement du monde, autrement dit de falsification intelligente du réel (de constitution de la « vérité-puissance » par le jeu des perspectives humaines et par la dynamique du pouvoir). Au XXe siècle, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper et Thomas Kuhn exploreront la nature de la vérité et le rôle multidimensionnel de la raison dans l’exercice et l’organisation de la recherche scientifique. L’avènement surfait du postmodernisme marquera d’abord l’abandon, par l’université et les milieux de la bien-pensance aux commandes stratégiques de la guerre de la rhétorique, le renoncement à l’idée même de vérité objective ; puis le développement du dogmatisme pluraliste encore dominant, décrétant qu’il ne peut être de « vérité » que relative et directement influencée et modelée par les effets de facteurs culturels, sociaux et historiques. Les universitaires divers portant de telles idées constructivistes sur le devant de la scène culturelle seront très fiers d’avoir « mis en lumière » cette notion de « vérité plurielle » se conjuguant au gré des modes de la modernité décadente et de ses métamorphoses postmodernes toutes plus colorées les unes que les autres.
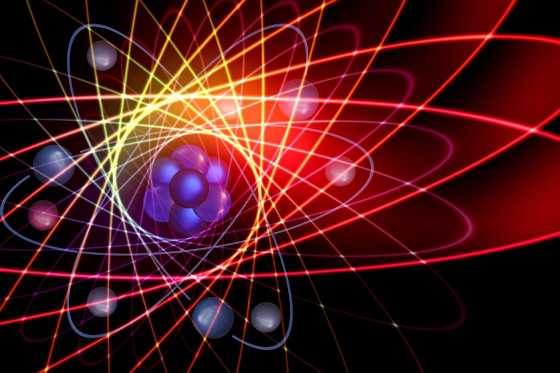 Il est enfin instructif de noter ici que du débat centré sur la vérité et la connaissance opposant, sans solution, l’empirisme et le rationalisme classiques (le premier de Locke et de Hume, le second de Descartes et de Kant), les travaux épistémologiques contemporains passeront à la curieuse opposition entre « internalisme » et « externalisme », le premier s’attachant à la question de savoir si les conditions de la connaissance sont des données « internes » aux états mentaux de l’individu ; ou si, d’après le second, elles dépendent plutôt de facteurs « externes », tels que la fiabilité des processus de formation des croyances. Le fiabilisme, ressortant de l’approche épistémologique dite externaliste, mettra l’accent sur l’importance des processus cognitifs de formation des croyances et de leur fiabilité en vue de déterminer la possibilité de qualifier une croyance de connaissance (comme le faisaient déjà les Mégariques évoqués plus haut, bien que sur la base de postulats méthodologiques fort différents). La théorie du cohérentisme, à son tour, émergerait pour contrer le fondationnalisme (qu’incarnent la théorie platonicienne des formes et le système aristotélicien des premiers principes) en soutenant que la connaissance tire son origine de la cohérence et de la consistance des croyances incorporées dans un système de perception aguerrie. Ce faisant, la vision cohérentiste se positionne également à l’encontre du rapport correspondantiste de la pensée, de sa traduction propositionnelle et du monde de leur objectivité référentielle commune – rapport canonique de la mesure du vrai prôné par les scolastiques, ainsi que par Pierce et Frege à la fin du XIXe siècle. Dans le cadre d’une telle théorie, la justification, à savoir l’assurance de vérité, provient non plus de principes fondamentaux, mais des relations qu’entretiennent les divers éléments de croyance d’un système de perception…….
Il est enfin instructif de noter ici que du débat centré sur la vérité et la connaissance opposant, sans solution, l’empirisme et le rationalisme classiques (le premier de Locke et de Hume, le second de Descartes et de Kant), les travaux épistémologiques contemporains passeront à la curieuse opposition entre « internalisme » et « externalisme », le premier s’attachant à la question de savoir si les conditions de la connaissance sont des données « internes » aux états mentaux de l’individu ; ou si, d’après le second, elles dépendent plutôt de facteurs « externes », tels que la fiabilité des processus de formation des croyances. Le fiabilisme, ressortant de l’approche épistémologique dite externaliste, mettra l’accent sur l’importance des processus cognitifs de formation des croyances et de leur fiabilité en vue de déterminer la possibilité de qualifier une croyance de connaissance (comme le faisaient déjà les Mégariques évoqués plus haut, bien que sur la base de postulats méthodologiques fort différents). La théorie du cohérentisme, à son tour, émergerait pour contrer le fondationnalisme (qu’incarnent la théorie platonicienne des formes et le système aristotélicien des premiers principes) en soutenant que la connaissance tire son origine de la cohérence et de la consistance des croyances incorporées dans un système de perception aguerrie. Ce faisant, la vision cohérentiste se positionne également à l’encontre du rapport correspondantiste de la pensée, de sa traduction propositionnelle et du monde de leur objectivité référentielle commune – rapport canonique de la mesure du vrai prôné par les scolastiques, ainsi que par Pierce et Frege à la fin du XIXe siècle. Dans le cadre d’une telle théorie, la justification, à savoir l’assurance de vérité, provient non plus de principes fondamentaux, mais des relations qu’entretiennent les divers éléments de croyance d’un système de perception…….
En logique, pour conclure ces quelques rappels, la notion de vérité est étroitement liée à celle de validité des arguments. Elle y est donc formellement abordée sous l’angle de propositions – d’énoncés linguistiques, mais encore mathématiques, que l’on va retrouver en informatique et en intelligence artificielle – répondant à des critères syntaxiques précis. Au sens classique, le travail des logiciens porte en premier lieu sur le développement de systèmes formels capables d’évaluer la vérité des propositions et des déductions entre assemblages sémantiques formulaires (vérifiant la production de « formules bien formées »). Les propositions sont considérées comme vraies si elles correspondent aux règles de la logique et aux axiomes du système de mise en œuvre de ces règles. La logique symbolique ou mathématique, développée aux XIXe et XXe siècles, va d’abord reprendre les bases de la syllogistique aristotélicienne, pour en dépasser les limites afférentes à la structure des termes de la langue courante (sujet/prédicat) et fournir des outils quantificationnels puissants pour la formalisation de la vérité et de la validité.
Lisez la troisième partie de cet article
yogaesoteric
15 décembre 2023
